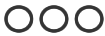Il fut un temps où les ports bruissaient d’équipages serrés dans huit mètres de coque. On y embarquait à quatre ou cinq, on dormait en enfilade dans des bannettes trop étroites, on cuisinait sur un réchaud brinquebalant, et l’eau douce se comptait au litre. C’était spartiate, oui, mais c’était joyeux. Aujourd’hui, ces petits croiseurs existent toujours, souvent impeccablement entretenus, disponibles au prix d’une voiture d’occasion. Mais dans les ports, ils semblent avoir disparu.
Les explications techniques ne manquent pas : tarifs portuaires dissuasifs, normes de sécurité plus strictes, goût croissant pour le confort individuel. Les gestionnaires privilégient les grandes unités, plus lucratives. Les petits, eux, s’entassent sur bers, attendant des acheteurs qui ne viennent plus.
Mais la vraie cause est ailleurs. En quarante ans, c’est notre rapport à l’aventure qui s’est métamorphosé. Les années 1980 toléraient l’inconfort comme la rançon de la liberté. Aujourd’hui, on exige cabines séparées, douche chaude et électronique omniprésente. Le voilier n’est plus “camping flottant collectif”, mais résidence secondaire sur l’eau. Les joyeux équipages d’hier ont laissé place à des couples quinquagénaires naviguant sur des quarante pieds climatisés.
Le paradoxe veut pourtant que la vie frugale ait trouvé un autre terrain : la route. La vanlife ressuscite exactement ce que le petit voilier incarnait autrefois — espace réduit, autonomie relative, nuits serrées, insouciance partagée. À une différence près : le van ne demande ni apprentissage ni affrontement avec les éléments. Un permis B suffit, et quelques filtres Instagram transforment l’expérience en liberté clé en main.
Reste que la voile, elle, impose toujours sa leçon de patience et d’humilité face au vent. Une liberté conditionnelle, exigeante, qui suppose d’accepter l’imprévu, l’inconfort et la solidarité. Un idéal qui ne séduit plus qu’une minorité, mais qui demeure, discret, au détour d’un vieux port ou d’une crique oubliée.