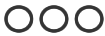On s’imagine volontiers l’Union européenne comme une innovation politique inédite : un continent réconcilié, débarrassé des frontières intérieures, doté d’une monnaie unique, engagé dans une aventure démocratique sans précédent. Pourtant, si l’on gratte un peu la surface, l’Europe actuelle ressemble étrangement à l’Europe d’avant 1789. Une Europe où l’on retrouve une élite transnationale polyglotte, et un peuple assigné à résidence linguistique et culturelle.
Une aristocratie européenne
À l’époque moderne, les cours d’Europe parlaient français. De Saint-Pétersbourg à Vienne, de Berlin à Varsovie, les nobles s’exprimaient dans la langue de Versailles, lisaient les mêmes auteurs, échangeaient dans une culture commune. Pendant ce temps, le peuple parlait une mosaïque de patois incompréhensibles entre eux, sans accès direct aux débats du temps.
Aujourd’hui, l’anglais a remplacé le français, mais la logique est la même : les élites politiques, économiques et universitaires européennes communiquent naturellement dans une langue commune, circulent librement de Bruxelles à Berlin, de Madrid à Copenhague, et se comprennent au-dessus des clivages nationaux. Pendant ce temps, la majorité des citoyens reste confinée dans sa langue nationale. La fracture est moins sociale que linguistique : l’Europe des élites parle ensemble, l’Europe des peuples reste silencieuse.
Un peuple fragmenté
Les institutions européennes aiment célébrer la “richesse du multilinguisme”. Vingt-quatre langues officielles, des centaines de dialectes protégés, des budgets colossaux pour les traductions. Mais ce pluralisme cache une réalité : l’absence d’un espace public commun. Chaque débat reste national, chaque opinion publique enfermée dans son idiome. Le citoyen français n’entend pas ce que disent les Espagnols, ni l’Allemand ce que pensent les Polonais. L’Europe, au quotidien, n’existe pas dans la langue du peuple.
Sous l’Ancien Régime, le paysan breton ne comprenait pas le paysan provençal. Aujourd’hui, le citoyen lituanien ne discute pas spontanément avec l’Italien ou le Portugais. Dans les deux cas, la fracture linguistique empêche l’émergence d’une conscience collective.
Une démocratie traduite
Ce décalage entraîne une conséquence politique majeure : l’Europe vit dans une démocratie traduite. Les institutions fonctionnent grâce à des bataillons d’interprètes et de traducteurs. Le citoyen accède au débat européen uniquement filtré par sa presse nationale. La parole commune n’existe pas, sinon sous une forme artificielle, technique, lissée. C’est une démocratie où les mots ne circulent pas directement, où l’opinion publique européenne n’a jamais l’occasion de se former.
Une régression historique ?
L’ironie est cruelle : alors que la Révolution française a justement brisé ce système en imposant une langue commune pour construire une opinion publique nationale, l’Europe contemporaine semble revenir à l’époque pré-révolutionnaire. Une aristocratie polyglotte, un peuple enfermé dans ses idiomes, et une fracture invisible mais profonde entre ceux qui participent et ceux qui restent spectateurs.
Conclusion : le vrai défi européen
L’Europe a abattu des totems majeurs de la souveraineté : la monnaie, les frontières. Mais elle refuse de toucher à la langue, dernier bastion identitaire. Ce choix condamne le projet fédéral à rester un projet d’élites, incapable de se traduire en expérience partagée par les peuples.
En ce sens, l’Union européenne n’est pas une démocratie moderne en construction : elle ressemble à une Europe de l’Ancien Régime, où la parole circule dans les salons, mais jamais dans les villages. Et tant qu’elle restera ainsi, le rêve d’une Europe politique ne pourra être qu’un château de Versailles sans peuple.