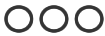On ne boit plus de vin à table. On méprise les abats, la cocotte mitonneuse, le beurre et le pain. Tout est “trop” : trop gras, trop sucré, trop salé, trop de gluten. L’époque a fait du goût un risque sanitaire, et du repas un champ de mines.
Le repas, jadis moment de joie, est devenu une scène de contrôle. On compte, on trie, on évite, on s’excuse. On mange comme on remplit un questionnaire médical. Les abats ? Trop forts. La charcuterie ? Cancérigène. Le vin ? Un poison. Quant à la cocotte, elle traîne encore dans quelques cuisines obstinées, vestige d’un monde où l’on savait encore attendre qu’un plat ait “le temps”.
Nous avons troqué la convivialité contre la vigilance, le plaisir contre la nutrition. On ne dîne plus ensemble : on se surveille mutuellement.
Le café noir du comptoir s’est noyé dans le lait d’amande, le saucisson a cédé la place au houmous de lentilles corail. On ne parle plus du terroir, mais du taux de fibres. Les restaurants n’ont plus de carte, mais des “options sans gluten”. Et le brunch — ce non-repas de fin de matinée — a remplacé le déjeuner : ni vin, ni pain, ni sauce, seulement des “bowls” et du “healthy”.
Notre gastronomie, jadis orgueilleuse, est devenue une clinique de l’assiette.
Derrière la diététique se cache une nouvelle religion : celle de la pureté. Celui qui boit un verre de rouge passe pour inconscient, celui qui met du beurre dans ses pâtes, pour suicidaire. Le ventre est suspect, la faim presque honteuse. Manger gras, c’est “ne pas se respecter”. Boire, c’est “manquer de maîtrise”. Nous voilà revenus à la morale chrétienne, mais sans le salut : le péché n’est plus dans l’âme, il est dans la digestion.
Et pourtant, c’est autour du repas que l’homme s’est civilisé. C’est en partageant le pain et le vin qu’il a appris la parole, le rire et la lenteur. Une sauce longue, un ragoût, un fromage fort : tout cela racontait le temps qu’on laisse faire, la confiance dans le feu, la transmission d’un geste. La cuisine, c’était le contraire de notre époque : patiente, imparfaite, humaine.
La cocotte mijote encore, quelque part, dans le silence des cuisines oubliées. Là où le feu vit, il reste un peu d’âme.
Je n’en veux pas à ceux qui pèsent leur quinoa et boivent de l’eau tiède : ils font ce qu’on leur dit de faire. Mais j’ai la nostalgie des tables bavardes, des nappes tachées, des verres qui s’entrechoquent. Des repas qui avaient le goût du monde, pas celui de la bonne conscience.
Un pays qui ne sait plus lever son verre finira par ne plus savoir lever les yeux.