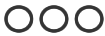Il m’a fallu du temps pour apprendre à partir. Du temps pour comprendre que la lucidité ne suffit pas, que voir clair n’est pas encore agir. J’ai souvent su avant d’oser. J’ai pressenti les liens qui me blessaient, les milieux où je n’avais plus ma place, les amitiés devenues pesantes. Mais je restais encore un peu, par décence, par fidélité, par peur aussi d’abîmer ce que j’avais aimé. On ne quitte pas sans effort les choses qui ont compté.
J’ai grandi dans un univers où l’on valorisait la loyauté, la retenue, le respect des formes. On m’a appris à ne pas claquer les portes, à ménager les susceptibilités, à faire en sorte que tout se passe bien, même quand rien n’allait plus. Cela m’a longtemps freiné. J’ai mis des années à comprendre que la fidélité cesse d’être une vertu lorsqu’elle devient une cage. On croit qu’on reste par bonté, mais souvent on reste par habitude, ou par peur de décevoir.
Être homosexuel a renforcé cette prudence. Quand on a vécu en marge, on sait qu’une rupture se paie toujours un peu plus cher. Alors on arrondit les angles, on évite le scandale, on veut rester “fréquentable”. On apprend à se fondre dans les codes, à respecter les convenances, à éviter d’ajouter une différence à la différence. Cela protège, mais cela use. La tolérance qu’on mendie finit par ressembler à une forme de servitude polie.
Pourtant, il vient un moment où la fatigue du mensonge l’emporte sur la peur du vide. On cesse d’attendre que les choses changent d’elles-mêmes, et l’on comprend qu’il faut partir. Pas pour s’enfuir, mais pour respirer. Ce n’est pas un cri, c’est un soulagement. On ne quitte pas contre, on quitte pour — pour soi, pour la paix, pour la vérité.
J’ai toujours voulu rompre sans abîmer. C’est une élégance qui me vient sans doute de cette éducation bourgeoise dont je me moque parfois, mais qui m’habite encore : ne pas humilier, ne pas détruire, ne pas faire plus de bruit qu’il n’en faut. Rompre proprement, c’est reconnaître ce qui fut sans le renier. Laisser derrière soi ce qui a compté, mais ne plus s’y attarder.
Avec le recul, je crois que ma lenteur à me détacher n’était pas une faiblesse. C’était le temps nécessaire pour transformer la colère en clarté. J’ai mis du temps, oui, mais aujourd’hui je sais que je suis libre — libre sans amertume, libre sans besoin de prouver quoi que ce soit.
On croit souvent que la liberté se conquiert dans un éclat. En réalité, elle se conquiert en silence, dans le moment où l’on cesse de se justifier. La liberté n’est pas un geste héroïque : c’est une mue. On se défait doucement des attentes des autres, on reprend sa respiration, on apprend à ne plus plaire, à ne plus réparer.
J’ai mis du temps, mais c’est ce temps qui m’a formé. Il m’a appris la patience, la nuance, la gratitude. Je ne regrette rien. Il faut parfois traverser beaucoup d’attachements pour mériter une forme simple de paix : celle d’être enfin à sa place, ni contre, ni ailleurs, mais debout.