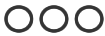Je viens d’écouter une conférence sur Hans-Hermann Hoppe, économiste allemand issu de l’école autrichienne et figure centrale du mouvement libertarien, dont Elon Musk et plusieurs milliardaires américains revendiquent aujourd’hui l’inspiration intellectuelle. Chez eux, Hoppe est presque un prophète : celui qui a mis des mots sur la conviction que l’État entrave la créativité, que la régulation tue l’innovation et que le marché, laissé à lui-même, est l’ordre naturel des choses. Dans cette vision, la démocratie n’est pas le sommet de la civilisation, mais son lent déclin.
Selon Hoppe, un roi pense à long terme parce qu’il possède le royaume et veut le transmettre intact ; un élu, lui, n’a qu’un bail à durée déterminée sur le pouvoir et en profite pour exploiter ce qu’il peut avant de le rendre. La démocratie, dit-il, transforme l’État en bien collectif dont chacun tire sa part, comme un champ pillé par des locataires pressés. De là naissent la dette, le court-termisme, la redistribution, la perte de la responsabilité individuelle et la décadence morale. Le seul ordre viable serait celui fondé sur la propriété privée, les contrats volontaires et la hiérarchie naturelle issue du mérite. L’État-providence serait donc, dans sa logique, une machine à infantiliser, et la démocratie, une entreprise de spoliation organisée.
J’ai écouté cette démonstration avec un mélange d’admiration et de malaise. Il faut reconnaître à Hoppe une rigueur implacable : il pousse jusqu’au bout la logique du libéralisme classique. Tout s’enchaîne, tout se tient, tout se justifie — et c’est précisément cela qui fait peur. Car derrière cette architecture théorique parfaite, il y a un monde sans faibles, sans fragiles, sans perdus. Un univers où la valeur d’un être se mesure à sa capacité d’autonomie, où la dépendance est une faute et la solidarité un vice.
Ce qu’il appelle responsabilité n’est pas vertu, mais calcul. Ce qu’il nomme ordre naturel n’est qu’un marché total. On sent derrière cette pensée la froideur de la raison économique lorsqu’elle prétend gouverner l’homme. Ce qu’elle oublie, c’est que l’humanité n’est pas seulement une mécanique d’incitations et de sanctions, mais une alchimie de chair, de hasard, de mémoire et d’amour.
Hoppe croit que la civilisation se détruit quand elle protège les faibles. Je crois au contraire qu’elle meurt quand elle cesse de le faire. Une société n’est pas civilisée parce qu’elle accumule du capital, mais parce qu’elle accepte de porter le poids de sa propre fragilité. La grandeur d’un peuple ne se mesure pas à son taux d’épargne, mais à sa capacité d’attention.
En écoutant Hoppe, j’ai compris qu’il incarne ce qu’il dénonce : une modernité dévitalisée, rationnelle jusqu’à l’inhumain, fascinée par la pureté du système. Il veut sauver la civilisation par la propriété ; elle ne se sauvera que par la générosité, la lenteur et le sens du lien. Gouverner ne devrait pas consister à posséder, mais à transmettre. Et transmettre, c’est toujours aimer un peu ceux qui ne sont pas encore là.