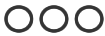J’ai longtemps cru que la politique était un débat d’idées, un affrontement d’arguments. J’ai fini par comprendre qu’elle est d’abord une lutte entre deux nostalgies. D’un côté, ceux qui veulent retrouver ; de l’autre, ceux qui veulent refaire. Les premiers cherchent un monde perdu, les seconds rêvent d’un monde à venir. Et entre eux, la majorité s’accroche simplement à continuer — sans trop se demander pourquoi.
Les uns parlent de racines, d’héritage, de frontières — non pas toujours par peur, mais par fidélité. Ils croient que la vérité se trouve dans ce qui a déjà existé, que l’homme est un être d’appartenance avant d’être un projet. Les autres invoquent la justice, l’émancipation, l’avenir — non pas toujours par naïveté, mais par espérance. Ils pensent que l’homme n’a pas d’essence fixe, qu’il se construit en se libérant.
Ces deux visions ne se rencontrent jamais vraiment. L’une regarde vers la terre, l’autre vers l’horizon. L’une croit à la continuité, l’autre à la rupture. Pourtant, elles ont en commun une même mélancolie : le sentiment d’avoir été dépossédées de ce qui faisait la grandeur du politique. Dans un monde gouverné par la gestion, les chiffres et la communication, elles osent encore parler de destin.
Elles sont minoritaires non parce qu’elles sont marginales, mais parce qu’elles exigent trop : une vision, une cohérence, une foi dans quelque chose de plus grand que soi. Elles dérangent, parce qu’elles réveillent le tragique dans un temps qui ne veut plus que du confort.
Au fond, elles sont les deux battements d’un même cœur inquiet : celui d’une civilisation qui ne sait plus si elle veut durer ou renaître.