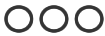On parle beaucoup de « mère patrie ». Et, en France, on dirait que l’État a pris ce rôle très au sérieux. Mère nourricière, mère protectrice, mère inquiète, mère intrusive aussi. L’épisode du « quoi qu’il en coûte » pendant le Covid, c’était exactement ça : ne vous inquiétez de rien, on paie, on amortit, on prend en charge, on suspend le réel le temps de la tempête. Tu restes à la maison, on s’occupe du reste.
Et depuis, le curseur n’est jamais vraiment revenu en arrière.
On a des guichets pour tout : aides pour payer, aides pour se déplacer, aides pour isoler sa maison, aides pour changer de chaudière, aides pour réparer son grille-pain, ateliers pour apprendre à repriser ses chaussettes. Assistance administrative, assistance psychologique, assistance pédagogique, assistance technique. Il y a toujours une plateforme, une subvention, un formulaire, un interlocuteur « dédié ». Jamais on ne nous dit simplement : débrouille-toi, tu vas y arriver.
Sur le papier, c’est rassurant. Un pays qui protège les plus fragiles, qui ne laisse pas les gens tomber, qui amortit les chocs économiques, sociaux, sanitaires, ce n’est pas exactement un cauchemar. Mais à force de pousser le curseur sur la protection, on a glissé vers autre chose : la maternité d’État.
Une mère patrie qui borde le lit, qui vérifie si on a bien pris son médicament, qui remplit les papiers avec nous, qui nous explique quoi faire quand notre grille-pain tombe en panne, comme si chaque citoyen était un ado un peu dépassé par la vie pratique.
Et puis il y a le grand absent : le « père patrie ».
Pas au sens viriliste, brutal, façon vieux patriarche autoritaire. Plutôt cette figure qui te regarde dans les yeux et te dit :
« Maintenant, c’est à toi. Tu prends tes responsabilités. Tu assumes. Je ne serai pas derrière toi à chaque seconde. »
Un État qui ne serait pas seulement là pour amortir, mais aussi pour cadrer, exiger, responsabiliser. Celui qui parfois met un coup de pied aux fesses plutôt que d’envoyer un tutoriel pour t’expliquer comment remplir ton dossier de demande d’aide.
On pourrait imaginer cette « père patrie » qui te dirait, très calmement :
– Tu veux des droits ? Très bien. Mais ils viennent avec des devoirs concrets, pas juste théoriques.
– Tu veux qu’on t’aide ? D’accord, mais tu participes, tu te formes, tu contribues.
– Tu veux qu’on prenne soin de toi ? Alors commence par prendre un peu soin de toi-même, de tes proches, de ta communauté.
Au lieu de ça, on a souvent le réflexe inverse : dès qu’un problème apparaît, on demande un nouveau guichet, un nouveau dispositif, une nouvelle aide. On invente un formulaire, un numéro vert, une plateforme en ligne. Le citoyen devient « bénéficiaire », « usager », « accompagné ». Il n’est plus vraiment acteur, encore moins responsable. On lui explique comment « activer ses droits », comme on activerait une option dans une application.
C’est peut-être là que le bât blesse : on parle rarement aux citoyens comme à des adultes capables d’encaisser une part de réalité brute.
Reconnaître que tout ne sera pas indemnisé. Que certains choix ont des conséquences. Qu’on ne peut pas demander en même temps un État nounou qui paye tout et un État léger qui ne nous demande jamais d’efforts. Qu’on ne peut pas éternellement transférer sur « la collectivité » ce qu’on ne veut pas assumer individuellement.
Ce n’est pas très agréable à entendre, évidemment. C’est plus confortable d’être pris en charge que d’être remis face à soi-même. Mais une démocratie adulte, ce n’est pas seulement un peuple protégé, c’est aussi un peuple qu’on traite comme capable de se tenir debout, d’accepter des contraintes, de traverser des épreuves sans avoir systématiquement un coussin sous chaque marche d’escalier.
Je ne dis pas qu’il faudrait remplacer la mère par le père, la douceur par le coup de pression permanent. Ce serait juste une autre caricature.
Mais on pourrait admettre qu’on a déséquilibré le contrat. Beaucoup de sollicitude, énormément de dispositifs, une empathie institutionnelle qui parfois frise le paternalisme inversé… et en face, très peu de discours clair sur l’effort, la responsabilité, la limite, la part de risque inhérente à la vie.
Peut-être que l’idéal serait une patrie qui sait faire les deux :
– côté « mère », protéger les plus fragiles, amortir ce qui est insoutenable, ne pas laisser des gens crever dans le fossé au nom d’une pseudo-vertu de l’autonomie ;
– côté « père », rappeler que tout ne sera pas compensé, que tout ne sera pas remboursé, que certaines choses dépendent de nous et que personne ne viendra, éternellement, rafistoler notre immobilisme.
On peut continuer à demander des aides pour réparer nos grille-pain et nos chaussettes trouées, pourquoi pas. Mais à un moment, il faudra bien se demander si on veut vivre dans un pays d’adultes ou dans une grande crèche high-tech avec protocole de bienveillance généralisée et formulaire CERFA pour gérer chaque imprévu.
La vraie maturité collective, ce ne serait pas de renoncer à la protection. Ce serait de l’accepter comme un filet de sécurité, pas comme un mode de vie.
Et d’oser dire : merci pour la main tendue… mais je préfère, de temps en temps, qu’on me laisse marcher sans roulettes, quitte à me prendre un trottoir dans le tibia.