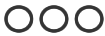Entretien imaginaire entre Bruno Paulet et Michel Onfray Blog Réflexions – automne 2025
Bruno Paulet : Michel, vous parlez souvent d’une “civilisation épuisée”. J’ai parfois l’impression, moi aussi, que nous marchons dans les ruines : celles du beau, de la pensée, de la conversation. Tout semble remplacé par le confort, la morale du bien-être et les slogans. Est-ce une impression d’homme vieillissant — ou un constat lucide ?
Michel Onfray : Ce n’est pas de la nostalgie, Bruno, c’est un diagnostic. Une civilisation meurt quand elle ne croit plus à ce qu’elle a produit. L’Europe a cessé de croire en la raison, en la beauté, en l’effort. Nous avons remplacé la transcendance par la technologie et l’espérance par la consommation. Ce n’est pas l’âge qui nous rend mélancoliques : c’est la lucidité.
Bruno : Mais cette lucidité est-elle encore utile ? Quand j’observe la société, j’ai parfois l’impression que tout discours exigeant est perçu comme réactionnaire. Le nivellement par le bas n’est-il pas devenu une valeur morale ?
Onfray : C’est exactement cela. Nous vivons sous la tyrannie de la bienveillance. Il ne faut plus blesser, plus juger, plus hiérarchiser. Tout doit être égal — les œuvres, les idées, les comportements. Or l’égalité, quand elle n’est plus un idéal politique mais une norme culturelle, devient une machine à fabriquer la médiocrité. On préfère une société où tout le monde se vaut à une société où chacun se surpasse.
Bruno : Mais le peuple que vous défendez, lui, n’est pas toujours admirable. Vous dites qu’il faut lui rendre la parole, mais parfois — quand il réclame la peine de mort, par exemple — il effraie. Peut-on faire confiance au peuple sans tomber dans le populisme ?
Onfray : Le peuple n’est ni sage ni fou. Il est humain. Il se trompe parfois, mais il sent juste. Lorsqu’il réclame la peine de mort, il exprime sa peur et sa colère, non sa cruauté. Il faut entendre cette émotion, pas la mépriser. Le mépris des élites nourrit la vengeance populaire. Une vraie démocratie consiste à écouter cette colère et à lui donner forme, pas à la censurer.
Bruno : Vous dites cela, mais dans le même temps vous rejetez le progressisme. Or le progressisme, au fond, c’est la promesse de l’égalité, de la liberté, du savoir pour tous. Pourquoi y voir un danger plutôt qu’un horizon ?
Onfray : Parce que le progressisme moderne est une religion sans dieu : il promet le paradis terrestre mais interdit toute critique. Il prêche la tolérance en excluant ceux qui ne parlent pas sa langue. Le progrès, quand il se fait sans limite, détruit ce qu’il prétend sauver : la culture, la beauté, la lenteur, la mesure.
Bruno : Je vous suis sur la mesure, mais pas sur la résignation. Vous parlez souvent de décadence comme d’un processus inévitable. N’est-ce pas une façon élégante de renoncer ?
Onfray : Non, c’est une façon lucide d’habiter le temps qui est le nôtre. Les civilisations naissent, croissent et meurent — comme les hommes. Ce n’est pas une tragédie, c’est une loi biologique. L’enjeu n’est pas d’empêcher la fin, mais de la vivre avec dignité. Je dis souvent : il faut être un moine dans les ruines, pas un prêcheur du salut.
Bruno : C’est beau, mais très nietzschéen, et peut-être un peu désespéré. Vous refusez la morale de la pitié, mais sans empathie, que reste-t-il de l’humain ?
Onfray : L’empathie est nécessaire, la pitié est mortelle. L’une comprend, l’autre humilie. L’empathie élève, la pitié abaisse. La société moderne adore la pitié parce qu’elle fabrique des victimes — et les victimes sont le capital moral de notre époque. La grandeur consiste à rester debout, pas à quémander la compassion.
Bruno : Et la beauté dans tout cela ? Vous dites que le beau est une éthique. Je partage cette idée : le beau rend Dieu inutile. Mais comment défendre la beauté dans une société qui ne la voit plus ?
Onfray : En la vivant, tout simplement. En cuisinant, en lisant, en marchant, en aimant. La beauté n’est pas une abstraction, c’est une manière d’habiter le monde. Elle ne sauvera pas le monde, mais elle le rendra habitable. Le beau est une forme de résistance : il oblige à ralentir, à regarder, à remercier.
Bruno : Donc vivre est déjà un acte esthétique ?
Onfray : Exactement. Chacun doit faire de sa vie une œuvre. Non par narcissisme, mais par gratitude. L’art de vivre est une politique : il oppose la joie à la peur, la création à la soumission.
Bruno : Mais comment enseigner cela, dans une école où l’on confond bienveillance et abandon, où la culture classique disparaît ?
Onfray : En redonnant à l’éducation son sens premier : transmettre. L’école doit instruire, pas flatter. Elle doit apprendre à lire, à écrire, à penser, à admirer. L’enfant doit rencontrer la difficulté, l’effort, la hiérarchie du savoir. On n’élève pas un esprit en le protégeant du vertige : on l’élève en lui donnant des ailes.
Bruno : Vous plaidez pour une éducation élitiste ?
Onfray : Non, pour une éducation exigeante. L’élitisme, c’est réserver le savoir à quelques-uns ; l’exigence, c’est le rendre accessible à tous par l’effort. Ce n’est pas la même chose.
Bruno : Et l’égalité des chances ? Vous dites qu’elle est un mythe, mais n’est-elle pas au cœur du pacte républicain ?
Onfray : Oui, mais un mythe utile à ceux qui veulent se donner bonne conscience. On ne naît pas égaux : les uns héritent d’un patrimoine culturel, d’autres d’un désert symbolique. Le rôle de l’école devrait être de compenser cela. Or elle aggrave la fracture. On parle d’inclusion, mais on pratique l’abandon.
Bruno : Alors que faire ? Est-ce encore réversible ?
Onfray : Peut-être pas collectivement, mais individuellement, oui. Il reste des foyers de résistance : des professeurs, des artisans, des lecteurs, des gens qui continuent à transmettre. Ce sont eux les vrais révolutionnaires. La décadence est globale, mais la dignité est personnelle.
Bruno : Vous parlez comme un stoïcien qui aurait lu Nietzsche. Mais n’est-ce pas désespérant de penser que la grandeur ne peut plus être collective ?
Onfray : C’est au contraire ce qui sauve l’homme : sa capacité à rester libre dans un monde qui ne l’est plus. La grandeur n’a jamais été collective. Elle naît d’individus debout, d’esprits libres. On n’empêche pas le monde de sombrer, mais on choisit comment sombrer.
Bruno : Une sorte de résistance du style ?
Onfray : Oui. Le style comme morale. La beauté comme politique. L’élégance comme réponse à la laideur.
Bruno : Une dernière question : vous croyez encore à la France ?
Onfray : Je crois à ce qu’elle a représenté : la langue, la clarté, la mesure, la conversation, l’art de vivre. Ce pays mourra peut-être comme corps politique, mais pas comme esprit — tant qu’il restera des gens pour en parler avec amour, sans mensonge.
Bruno : Alors nous continuerons à parler. C’est peut-être ça, la vraie fidélité : ne pas se taire.
Onfray : Exactement. Philosopher, c’est refuser le mutisme des ruines.