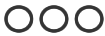Il y a dans le rapport que les Néerlandais entretiennent avec la culture américaine quelque chose de fascinant, presque viscéral. Ce n’est plus de l’admiration, c’est un réflexe. Quand les États-Unis éternuent, l’Europe met une casquette Yankees. Les générations plus âgées vibrent encore au son de Bruce Springsteen, citent Apocalypse Now comme une épopée biblique et lisent Moby Dick comme un texte fondateur de la modernité. Les jeunes, eux, ont troqué le rock pour le rap, mais la ferveur reste la même. Leurs mots, leurs vêtements, leurs références respirent l’Atlantique Ouest. Dans les bureaux comme sur les campus, on “ghost”, on “cancel”, on “hate on” — autant de tics de langage importés sans résistance. La Silicon Valley a remplacé le catéchisme calviniste : son évangile est celui du like et de l’efficacité.
Pendant longtemps, l’Amérique a eu tout pour séduire. Elle représentait la liberté, l’audace, la modernité décomplexée. Elle semblait être l’antidote à la lourdeur européenne, à ses hiérarchies, à ses lenteurs. Mais l’image s’est fissurée. La réélection de Donald Trump, la violence endémique, les fractures raciales, les universités hystérisées ont montré l’envers du rêve. L’Amérique a cessé d’être un modèle : elle est redevenue un miroir. Et ce que l’on y voit aujourd’hui, c’est la fragilité de la démocratie, la solitude derrière la réussite, le vide sous la performance.
C’est peut-être dans ce désenchantement que la France refait surface. Non pas comme une nostalgie, mais comme une alternative. Plus lente, plus nuancée, plus obstinée dans sa quête de sens. Les Français n’ont jamais renoncé à la conversation, à la gastronomie, à la littérature, à cette manière singulière d’unir la pensée et le style. On se moque de leur arrogance, mais on continue d’y chercher une forme de résistance : celle du doute, du verbe, de la nuance. Il y a dans la langue française — malgré son recul — une autre manière de se tenir au monde : moins marchande, plus existentielle, plus ironique aussi.
De Camus à Truffaut, de Duras à Godard, les créateurs français ont façonné une esthétique de la complexité qui résiste encore à la simplification numérique. La France rappelle qu’il est possible d’être moderne sans être amnésique, cultivé sans être élitiste, profond sans être moralisateur. Dans un monde obsédé par le succès, elle incarne la persistance du sens.
Car c’est bien là que tout se joue : entre le “winner” et le “flâneur”. L’Américain fascine parce qu’il gagne, il avance, il ose. Le Français intrigue parce qu’il doute, parce qu’il questionne. Et peut-être qu’aujourd’hui, après des décennies d’épuisement, d’hyperconnexion, de “burn-out” collectif, le flâneur redevient fréquentable. Redécouvrir la culture française, ce n’est pas céder à la nostalgie : c’est réapprendre à respirer, à accorder de la valeur à la lenteur, à la conversation, à la beauté.
Et si, au lieu d’importer les hamburgers, les Néerlandais importaient à nouveau les idées ? Et si, au lieu de passer leurs soirées devant Netflix, ils rouvraient Madame Bovary ou Les Misérables ? Ce n’est pas un hasard si une journaliste néerlandaise a pu écrire : “Sans la France, les États-Unis n’auraient jamais appris à s’aimer.” Car c’est en puisant dans l’esthétique, la pensée, la cuisine, la mode et le cinéma français que l’Amérique a forgé son propre imaginaire. La culture américaine est un spectacle ; la culture française, elle, en a écrit le scénario.
Il ne s’agit pas d’échanger une idolâtrie contre une autre. La France n’est pas un modèle parfait : elle doute, elle râle, elle se replie souvent sur elle-même. Mais elle porte encore quelque chose d’essentiel — une vision du monde où la beauté, la morale et la liberté ne s’opposent pas. Les Néerlandais, et plus largement les Européens, gagneraient peut-être à regarder de nouveau vers le Sud plutôt que vers l’Ouest. Car l’Europe n’a pas besoin d’un rêve américain : elle a besoin d’un sens européen. Et la France, malgré ses failles, en détient encore la grammaire.