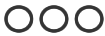Il est devenu banal de dire que les Lumières ont libéré l’homme de la superstition. Mais cette libération n’a pas surgi d’un coup. Elle fut le fruit d’un lent déplacement du regard, amorcé bien avant Voltaire ou Diderot. Tout a commencé avec la Renaissance, quand l’homme s’est redécouvert lui-même, à travers les textes, la langue, la beauté du monde. C’est là, dans cet éveil discret, que s’est préparée la grande révolution intérieure qui donnerait naissance à la raison critique, au progrès et à l’individualisme moderne.
Au Moyen Âge, l’homme ne se concevait pas encore comme centre du monde. Il n’était qu’un reflet de Dieu dans un cosmos ordonné, hiérarchisé, habité par le sacré. L’Église, la royauté, les corporations formaient les organes d’un même corps spirituel. Pourtant, à l’intérieur même de ce monde clos, un changement s’amorçait. Avec Thomas d’Aquin, on commence à dire que la raison humaine, don divin, peut comprendre le monde. La nature devient un livre qu’il est possible de lire, et non plus seulement de craindre. Dans la foi elle-même naît la confiance dans la raison — une première fissure dans le mur du sacré.
Puis, au XIVᵉ siècle, dans l’Italie des cités marchandes, l’esprit change de cap. Les manuscrits antiques ressurgissent, et les voix de Cicéron, de Sénèque ou de Virgile se remettent à parler. Pétrarque, que l’on considère souvent comme le premier humaniste, écrit qu’il veut « connaître l’homme intérieur ». Il ne cherche plus le salut dans la seule prière, mais dans la beauté, dans la pensée, dans l’amour. L’humanisme naît là, dans cette émotion nouvelle : celle de découvrir que l’homme est capable de sens, même sans médiation divine.
Au siècle suivant, la Renaissance proclame la dignité de l’homme. Pic de la Mirandole écrit : « Dieu a placé l’homme au centre du monde pour qu’il se façonne lui-même. » Cette phrase résume tout le basculement. L’homme devient son propre créateur, et le monde son atelier. Léonard de Vinci dissèque le corps comme une œuvre d’art, Copernic ose déplacer la Terre, Érasme traduit les Évangiles pour les rendre à tous. La foi n’est pas reniée, mais elle se fait plus intime, plus morale. Dieu cesse d’être un roi lointain : il devient une présence intérieure.
Puis vient le temps de la raison. Au XVIIᵉ siècle, avec Descartes, Galilée, Newton, la pensée se dote d’une méthode. L’esprit humain n’est plus un miroir passif : il devient instrument. Le monde cesse d’être mystère pour devenir mécanisme. Ce qui naît alors, c’est une foi nouvelle, non plus en Dieu, mais dans la raison elle-même. L’humanisme, né de la confiance en la raison divine, enfante un rationalisme qui n’a plus besoin de Dieu. La raison devient le nouvel absolu.
Au XVIIIᵉ siècle, cette foi rationnelle se fait politique. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu veulent fonder la morale et la justice sur l’homme seul. L’humanité devient son propre législateur. C’est un immense élan d’émancipation, mais aussi le point de bascule : en se libérant du sacré, l’homme s’est libéré de toute limite. L’humanisme a enfanté les Lumières, et les Lumières, à leur tour, ont ouvert la voie au désenchantement moderne.
Ce mouvement, qui a donné à l’Europe sa grandeur, porte aussi son excès. L’éducation, la science, la liberté de conscience sont nées de l’humanisme, mais aussi cette conviction que l’homme peut tout résoudre seul. De Socrate à Descartes, le centre de gravité du monde s’est déplacé : d’abord de Dieu vers l’homme, puis de l’homme vers la machine. Peut-être sommes-nous aujourd’hui au terme de ce cycle. L’humanisme a accompli sa mission : il a libéré l’homme. Il lui reste à se réconcilier avec ce qu’il a voulu dépasser — le mystère, le sacré, la limite.
L’humanisme n’a pas détruit le christianisme : il l’a transformé. Et les Lumières n’ont pas détruit l’humanisme : elles l’ont poussé à son extrême. Ce que nous appelons la crise de la modernité n’est peut-être rien d’autre que la fatigue d’un monde qui, depuis sept siècles, tente de vivre de sa propre lumière.