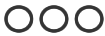Il y a des penseurs qui ne vieillissent pas parce qu’ils ne défendent pas une idéologie, mais une attitude intérieure. John Stuart Mill fait partie de ceux-là. Fils des Lumières, il a poussé plus loin que quiconque la foi dans la raison, tout en y ajoutant quelque chose que les philosophes de son temps oubliaient souvent : le respect du singulier. Il ne cherche pas à imposer un système, mais à défendre une manière d’être au monde. Dans une société où l’opinion règne en maîtresse, il demeure l’un des rares penseurs de la liberté intérieure et de la tolérance active.
Chez lui, la liberté n’est pas un simple droit que l’on réclame, mais une discipline que l’on s’impose. Il avait cette phrase magnifique : « Si toute l’humanité, moins un seul individu, était du même avis, elle n’aurait pas plus le droit de faire taire cet individu que celui-ci n’en aurait de faire taire l’humanité entière. » Ce qu’il redoutait, ce n’était pas la tyrannie d’un despote, mais celle, bien plus subtile, de la majorité. Celle du conformisme, des dogmes moraux, de la bien-pensance collective qui condamne avant de comprendre. Il voyait déjà venir ce que nous vivons aujourd’hui : la peur d’être dissonant, la crainte d’aller contre le courant. Être libre, pour lui, c’est oser penser différemment sans devenir sectaire, affirmer sa voix sans écraser celle des autres.
Mill reprend l’utilitarisme de Bentham, mais il y met une âme. Pour lui, le bonheur ne se résume pas à la quantité de plaisir, mais à la qualité de ce qu’on vit. Il écrivait : « Mieux vaut être un homme insatisfait qu’un porc satisfait. » Cette distinction entre plaisirs supérieurs et plaisirs inférieurs dit tout de sa philosophie : mieux vaut penser, créer, douter même, que de s’endormir dans la satisfaction immédiate. C’est un utilitarisme du discernement, où la dignité vaut mieux que le confort, et la recherche du vrai plus que le consensus.
Sa défense de la tolérance est tout aussi exigeante. Elle n’a rien de mou ni de complaisant. Il la voit comme une nécessité vitale pour la civilisation. Les opinions minoritaires, les modes de vie singuliers, les existences en marge ne sont pas des anomalies : ce sont des laboratoires du progrès moral. C’est dans l’écart, pas dans la conformité, que l’humanité avance. Mill nous rappelle que la vertu sans liberté devient hypocrisie, et que la diversité des existences est une forme d’intelligence collective. La tolérance n’est pas faiblesse : c’est une force du regard, une éducation de la patience, un art d’écouter sans vouloir corriger.
Il croyait encore au progrès, mais à un progrès mesuré non par les machines, mais par la qualité morale des individus. Il redoutait déjà une société où l’efficacité remplacerait le sens. L’homme libre, disait-il, est celui qui sait mettre des limites à ses désirs, qui refuse de déléguer à la technique ou à l’État la responsabilité de sa conscience. Cette idée résonne avec une intensité nouvelle aujourd’hui : comment rester soi dans le vacarme collectif ? Comment préserver sa liberté intérieure sans basculer dans le rejet de l’autre ? Mill répond par une formule simple et courageuse : il faut cultiver le courage tranquille d’être différent, sans mépriser ceux qui ne le sont pas.
John Stuart Mill incarne une tolérance exigeante, lucide et vivante. Tolérance envers les idées qui dérangent, envers les vies qui s’écartent, et même envers soi-même, quand on ne pense pas comme tout le monde. Mais cette tolérance n’est pas un abandon : c’est une vigilance, un art du discernement, une éthique du dialogue. Il nous rappelle, à une époque saturée d’opinions et de jugements, que la liberté n’est pas la victoire du plus fort, mais la respiration du singulier au sein du commun.