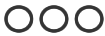Notre époque célèbre l’école comme un sanctuaire de bienveillance. On y apprend à s’écouter, à coopérer, à éviter les heurts. Les notes s’adoucissent, les mots durs disparaissent, les hiérarchies s’effacent. On ne parle plus d’autorité, mais d’accompagnement ; plus de discipline, mais de cadre souple ; plus d’exigence, mais d’épanouissement. L’intention est belle, humaine, généreuse. Mais je me demande souvent si, à force de vouloir protéger les enfants, nous ne les privons pas de ces épreuves qui forgent le caractère.
Car le caractère, lui, ne naît pas du confort. Il se trempe dans la résistance. Apprendre, c’est aussi échouer, recommencer, supporter la frustration, affronter le réel dans ce qu’il a de lent, de dur, d’indifférent. Or, j’ai l’impression que l’école moderne cherche de plus en plus à éviter ces confrontations. On ne redouble plus, on “avance autrement”. On ne corrige plus, on “valorise la démarche”. On ne punit plus, on “rétablit le dialogue”. Tout devient lisse, sans aspérité, comme si le monde pouvait être rendu inoffensif. Mais dans une mer sans vagues, personne n’apprend à nager.
Ce qui me frappe aussi, c’est cette peur de distinguer, de hiérarchiser, de juger. L’école ne veut plus blesser, alors elle égalise. On ne distingue plus l’effort du relâchement, le travail de la distraction. Tout se vaut. C’est une forme d’humanisme, mais qui finit par appauvrir. Car se confronter à la différence, à la réussite de l’autre, n’a rien d’humiliant : c’est souvent stimulant. La comparaison, quand elle est juste, donne envie de s’élever. Supprimer toute hiérarchie, c’est ôter à l’enfant le sens de l’excellence. Et une société qui a peur de dire “non” finit par ne plus savoir dire “oui”.
Je vois aussi combien notre temps redoute la contradiction. Le désaccord est vécu comme une violence. On confond dialogue et adhésion, discussion et validation. Pourtant, c’est dans le heurt des idées que se forme le jugement. Apprendre à penser, c’est accepter d’être contredit, oser défendre une position, douter sans se renier. Mais l’école d’aujourd’hui valorise le consensus, la parole apaisée, le climat serein. Elle oublie que le débat n’est pas la guerre : c’est un apprentissage de la liberté.
La bienveillance n’est pas un mal en soi. C’est même une belle idée. Mais quand elle devient sans limite, quand elle cesse d’être exigeante pour devenir simplement confortable, elle n’élève plus : elle endort. On fabrique alors des individus sensibles mais fragiles, émotifs mais démunis. Ils savent parler, mais pas tenir tête. Ils réclament d’être entendus, mais supportent mal la contradiction. Ils se sentent blessés dès qu’ils sont jugés, comme si la vie devait toujours ménager leur ressenti. Le résultat, c’est une génération douce, mais désarmée — pleine d’émotions, vide de colonne vertébrale.
Je ne crois pas qu’il faille revenir à l’autoritarisme d’hier. Mais je crois qu’il faut redonner sens à l’effort, au mérite, à la distinction. Apprendre à échouer, à recommencer, à se confronter au réel, c’est apprendre à vivre. L’existence, elle, ne distribue ni mentions d’encouragement ni points de participation. Former des caractères, ce n’est pas fabriquer des vainqueurs, mais des êtres capables de tenir debout, d’affronter la contradiction, de transformer l’adversité en conscience.
Une éducation qui supprime la difficulté supprime la croissance. Une école sans épreuve prépare des adultes sans élan. L’enfant qu’on n’a pas confronté à la limite deviendra un adulte qu’elle effraie. Et c’est peut-être là le drame discret de notre époque : nous avons voulu le bien-être des enfants, et nous avons oublié leur devenir.