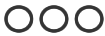Je n’ai jamais eu peur du numérique. Je l’ai même aimé. Il m’a offert des outils, des espaces, des rencontres, une liberté nouvelle. Pendant des années, j’y ai cru sincèrement. J’ai vu dans les technologies un moyen d’élargir le monde, d’abolir les distances, de rapprocher les hommes. Et je continue à penser qu’il y a là une promesse immense.
Car le numérique a aussi quelque chose de profondément humain : il relie des hommes qui, sans lui, ne se seraient jamais trouvés. Des êtres singuliers, souvent isolés, parfois blessés, qui portent en eux des désirs, des passions, des curiosités qu’ils n’osaient partager. Il permet de briser la solitude de ceux qui se croyaient seuls à aimer ce qu’ils aiment, à ressentir ce qu’ils ressentent. Sous la froideur de ses interfaces, il abrite parfois une fraternité inattendue — fragile, mais réelle.
C’est peut-être pour cela que je ne l’ai jamais rejeté. Je lui suis reconnaissant de ce qu’il rend possible : la rencontre des différences, la mise en relation de ceux qui n’ont pas de lieu commun. Ce que je refuse, ce n’est pas le numérique, mais le tout-numérique. Cette dérive où l’écran cesse d’être un outil pour devenir un filtre, où la connexion remplace la présence, où la vitesse étouffe la profondeur.
Avec le temps, j’ai senti le besoin de retrouver le poids du réel, la lenteur d’une conversation, la sincérité d’un silence partagé. J’avais besoin de sentir à nouveau que la parole pouvait être un acte et non un flux. C’est de là qu’est née l’idée de DL-Frat.
DL-Frat n’est pas un projet technologique. C’est un lieu d’âme. Une manière de rappeler que la chaleur d’une amitié, la pudeur d’une écoute, la confiance tissée dans le temps valent infiniment plus que toutes les connexions réunies. C’est un espace où des hommes différents, parfois en marge, peuvent être eux-mêmes sans justification ni masque. Une fraternité née du numérique, mais qui cherche à le dépasser — à lui redonner un cœur battant.
Je ne cherche plus le bonheur au sens où on l’entend aujourd’hui. Je ne veux plus de cet état lisse et sans faille que vendent les algorithmes et les coachs de vie. Le bonheur, tel qu’on le conçoit, me semble être une forme douce de résignation. Ce que je cherche, c’est l’épanouissement : une vie qui a du relief, de la densité, de la présence. Une vie où l’on se heurte, où l’on apprend, où l’on doute, mais où l’on avance.
J’aime la beauté. Pas celle qui s’exhibe, mais celle qui résiste au temps. J’aime les objets anciens, les lieux porteurs d’histoire, les choses patinées par la main humaine. Ce sont elles qui me rappellent qu’avant la vitesse, il y avait la durée ; qu’avant la nouveauté, il y avait la transmission. La beauté, pour moi, n’est pas un luxe, c’est une fidélité : à ce qui a été, à ceux qui ont fait, à ce qui demeure.
Le numérique, dans le meilleur de lui-même, peut servir cette fidélité : il peut transmettre, préserver, relier des âmes sensibles à la même lumière. Mais il ne doit jamais remplacer le réel. Il doit rester un pont — pas un refuge.
Aujourd’hui, je continue à utiliser les outils numériques, mais autrement. Ils ne sont plus mes fenêtres sur le monde, mais des passerelles entre des êtres. Je ne crois plus à la société de la fluidité. Je crois aux hommes qui, malgré la vitesse, prennent encore le temps de se parler.
Ce n’est pas un manifeste, encore moins une nostalgie. C’est simplement une conviction forgée par l’expérience : nous ne nous sauverons pas par la technologie, mais par la qualité de nos liens. Le bonheur est un état ; l’épanouissement, une œuvre. Et c’est cette œuvre-là, patiente, fraternelle, ancrée dans la beauté des choses simples, que je veux poursuivre.