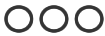La démocratie est malade de ses hommes politiques. Non parce qu’ils seraient plus corrompus qu’autrefois, mais parce que leur fonction a changé de nature. Jadis, certains entraient en politique par vocation, mus par le sens du bien commun, la passion du verbe et de la cité. Mais il ne faut pas se raconter d’histoires : il y avait aussi les autres, les ambitieux, les courtisans, les amateurs de prébendes et de faveurs, ceux qui confondaient intérêt général et intérêt personnel. Les juges regardaient ailleurs, la presse était plus indulgente, et l’opacité servait souvent de paravent. L’homme politique d’hier n’était pas forcément plus vertueux, seulement moins exposé.
Ce qui a changé, c’est le contexte : la transparence est devenue règle, les réseaux sociaux tribunal, la justice sentinelle. La moindre erreur devient affaire d’État, la moindre phrase malheureuse un scandale numérique. La politique s’est aseptisée sous le regard permanent de la caméra. On gouverne désormais avec des communicants, des avocats, des conseillers en image. La prudence a remplacé la vision, la stratégie la conviction. On ne rêve plus d’un pays, on gère des flux.
Et puis, il y a cette rupture silencieuse qu’on n’a pas assez mesurée : la fin du cumul des mandats. Elle a sans doute moralement assaini la vie politique, mais elle a aussi déraciné ses acteurs. Le député n’est plus maire, il ne sent plus battre la vie d’un village, il ne croise plus les regards qu’il représente. Il s’est éloigné du bitume, du marché, du bistrot. Il n’est plus à portée de voix, ni même à portée de baffes. Il vit désormais dans la bulle parisienne, dans la foire d’empoigne médiatique, dans la rumeur des couloirs et des micros tendus. Il parle au nom du peuple, mais il ne le voit plus.
Il ne s’agit pas de pleurer le passé, mais de constater que la politique s’est dématérialisée, devenue un métier du langage et de l’écran. Le pouvoir attire moins les âmes fortes que les profils prudents, ceux qui savent durer dans l’ère du soupçon permanent. La démocratie, elle, se peuple de gestionnaires raisonnables, de députés fonctionnaires, d’orateurs sans chair. Elle n’est plus portée par des voix, mais par des procédures.
Et pourtant, une démocratie sans incarnation se fane. Elle a besoin de visages, de contradictions, de caractères. Pas de saints, pas d’hommes providentiels, mais de personnalités vivantes, faillibles, enracinées. Des êtres capables d’assumer la complexité du réel sans la fuir dans la communication.
La démocratie ne meurt pas d’un coup. Elle se fatigue de ne plus avoir de souffle, de ne plus reconnaître ceux qui la dirigent. Elle se méfie, se replie, s’abstient. Ce qu’il lui manque, ce n’est pas un sauveur, mais un peu d’âme — ce lien vivant entre la parole publique et la vie ordinaire, entre la raison d’État et le cœur des hommes.