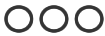Il y a dans Le Crabe-Tambour quelque chose d’un adieu — à une génération, à une certaine idée de la France, à une conception de la vie où la fidélité comptait davantage que le succès. Ce film n’est pas une œuvre de guerre, ni même une épopée maritime : c’est une élégie.
Une lente navigation vers la mémoire, où trois hommes se souviennent d’un quatrième — Willsdorff — et, à travers lui, d’eux-mêmes, de ce qu’ils furent, de ce qu’ils ont perdu.
Willsdorff, le Crabe-Tambour, reste presque invisible. Il est la figure d’un homme debout au milieu des ruines, fidèle à son idéal jusqu’à la solitude. Ancien officier, héros des guerres coloniales, il a choisi de s’effacer, de devenir pêcheur sur les bancs de Terre-Neuve. Autour de lui, le film reconstruit non un portrait, mais une légende morale : celle de l’homme qui continue à tenir la barre quand le monde se délite. Conrad avait écrit : « L’homme se juge à la manière dont il tient la barre. » Schoendoerffer, lui, filme cette phrase : il en fait un visage, un silence, un regard vers l’horizon.
Le commandant (Jean Rochefort), le médecin (Jacques Perrin) et le chef mécanicien breton (Jacques Dufilho) ne sont pas des compagnons de route : ce sont des fragments d’un même homme, trois façons de survivre à la défaite. Le commandant incarne la fidélité hiératique, celle du devoir et du commandement — l’honneur sans illusion, la rigueur d’un geste accompli sans témoin. Le médecin, lui, représente la lucidité : c’est l’intelligence blessée, la conscience d’un monde où l’honneur ne sauve plus, mais où il reste malgré tout la seule chose à sauver. Et le mécanicien breton, ivre de mer et de légendes, c’est la foi naïve, la croyance viscérale en quelque chose de plus grand que soi. Il parle des saints, des miracles, du surnaturel comme un vieux marin qui confond la prière et la superstition. Mais dans son regard, il y a une sagesse que ni le médecin ni le commandant ne possèdent plus : la capacité de croire malgré tout.
Ces trois hommes, enfermés sur un navire perdu dans la brume, évoquent leur passé comme on récite une litanie. Ils ne cherchent ni à comprendre ni à se justifier. Ils se souviennent pour ne pas trahir. Et dans cette fidélité muette, Schoendoerffer dit tout : la noblesse d’une génération condamnée à disparaître, la grandeur sans gloire, l’héroïsme inutile mais pur. Ce ne sont pas des vainqueurs, mais des hommes debout. L’époque les a dépassés, mais leur silence vaut toutes les victoires.
Le Crabe-Tambour, c’est la France blessée de l’après-guerre, celle qui a perdu ses colonies, ses illusions, sa fierté. Mais c’est aussi, plus largement, l’histoire de tous les hommes que le progrès a rendus inutiles. Schoendoerffer filme ces marins comme d’autres filment des statues. Ce ne sont pas des héros : ce sont des témoins. Ils portent encore sur leurs visages l’écho d’un monde où la parole donnée avait du poids, où l’on mourait pour moins que ça, mais avec plus de sens.
Et pourtant, le film n’est pas nostalgique. Il ne glorifie pas le passé : il le contemple avec pudeur, en sachant qu’il ne reviendra pas. La fidélité dont il parle n’est pas une posture, mais une manière d’être au monde. Fidélité à la parole donnée, au souvenir, à ce que l’on a aimé — même quand cela n’a plus de place dans le présent.
C’est pourquoi la mer y est filmée comme un purgatoire. Le navire avance dans le froid, la brume, le vent ; c’est une traversée intérieure. Chacun de ces hommes cherche une forme de rédemption : le commandant par la rigueur, le médecin par la compréhension, le mécanicien par la foi. Tous, à leur manière, approchent la mort avec cette paix résignée que seuls connaissent ceux qui ont cessé de tricher.
Schoendoerffer n’est pas un cinéaste religieux, mais son film est profondément spirituel. Il y a dans ses images une foi sans dogme, une prière sans autel. Le Crabe-Tambour devient une figure christique : un homme qui s’efface pour rester fidèle à ce qu’il croit juste. Son chat, sa jonque, la fumée d’opium — tout cela n’est pas fuite, mais ascèse. L’opium n’endort pas, il apaise. La jonque n’exile pas, elle recueille. Le chat n’anime pas sa solitude, il la rend supportable. Ces images disent une même chose : la réconciliation.
Ce film me touche parce qu’il parle d’un monde qui ne cherche plus la pureté, mais qui se souvient de ce qu’elle a coûté. Il me parle parce que je sens, dans le regard de ces hommes, ce mélange de fatigue et de fidélité que notre époque ne comprend plus. Nous vivons dans un temps où tout se justifie, où l’honneur fait sourire. Eux se taisent, mais ils tiennent bon.
Quand le générique s’efface, il ne reste que le vent, la mer et cette question que chaque homme devrait se poser : comment je tiens la barre ? Non pour triompher, mais pour ne pas trahir. Tenir la barre, c’est continuer d’être soi quand plus rien n’y oblige. C’est refuser la dérive, ne serait-ce que pour l’exemple.
Le Crabe-Tambour n’est pas seulement un film sur la mer ou sur la guerre ; c’est un film sur la fidélité. Il nous rappelle que la grandeur n’est pas dans la victoire, mais dans la constance, et que la seule chose qui sauve encore l’homme, c’est la manière dont il affronte le vent.