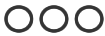La question gêne. Elle grince même. Presque indécente. Parce qu’elle bouscule une croyance confortable : la démocratie comme fin naturelle de l’histoire, ligne d’arrivée après les chaos. La poser, c’est déjà douter. Admettre que la démocratie n’est pas un acquis mais un état transitoire. Fragile. Réversible. Et que, pendant qu’on regardait ailleurs, le monde a peut-être changé de logiciel.
Car le monde redevient impérial. Pas avec des aigles et des casques dorés. Plutôt avec du rapport de force brut, des hiérarchies assumées, des puissances qui commandent et des dépendants qui s’adaptent. Le droit y pèse moins que la survie, la morale moins que l’efficacité. Dans ce décor-là, la démocratie n’est plus la règle implicite. Elle devient l’exception. Et une exception sommée de faire ses preuves.
Peut-elle tenir sans muter ? Réponse honnête : non. Mais la vraie inquiétude est ailleurs. Jusqu’où peut-elle se transformer sans perdre son nom ?
Premier angle mort : croire la démocratie hors-sol. Comme si elle flottait au-dessus des réalités matérielles, stratégiques, historiques. Or la démocratie européenne s’est bâtie dans une parenthèse rare : paix relative, mondialisation peu coûteuse, sécurité externalisée, abondance anesthésiante. Un équilibre reposant sur des béquilles bien identifiées : protection militaire américaine, usines chinoises, droit international respecté tant qu’il n’entravait pas les intérêts vitaux. Quand ces piliers craquent, ce n’est pas une faillite morale qui apparaît, mais une vulnérabilité très concrète.
Dès lors, la contradiction est frontale. La démocratie veut rester souveraine sans payer le prix de la souveraineté. Or sortir des dépendances — militaires, industrielles, technologiques, énergétiques — suppose des investissements lourds, des coûts durables, des renoncements immédiats. Et surtout un effort collectif consenti. Problème : la démocratie vit du consentement. Et le consentement s’érode vite quand le quotidien se tend. Là où l’empire impose, la démocratie négocie. Faiblesse stratégique, mais noblesse politique. Coincée entre deux risques : ne rien faire et dépendre, agir trop vite et fracturer.
À cela s’ajoute une autre ligne de fracture, plus récente : le numérique. Plateformes privées, cloud étranger, intelligence artificielle opaque, réseaux sociaux polarisants. Une démocratie qui ne maîtrise ni ses outils d’information ni ses infrastructures s’expose à une fragilisation permanente. Désinformation, soupçon, paralysie du débat. En arrière-plan, une conflictualité diffuse — cyberattaques, sabotages invisibles, érosion lente de la confiance. Pas une guerre ouverte. Une usure. Et l’usure est l’ennemie intime des démocraties.
Il y a aussi le déficit de récit. L’empire raconte simple : unité, grandeur, continuité. La démocratie, elle, compose avec des histoires multiples, parfois dissonantes. Impossible d’imposer un mythe sans se renier. Mais impossible aussi de survivre sans minimum commun. Ce récit ne peut être ni ethnique, ni religieux, ni guerrier. Il est politique : accepter le conflit sans accepter la domination, placer la loi au-dessus des chefs, préférer la correction permanente aux vérités figées. C’est moins spectaculaire. Plus exigeant. Et nettement plus difficile à transmettre.
Enfin, l’érosion vient de l’intérieur. Vieillissement, immigration mal intégrée, individualisme poussé à l’os, recul du lien social, territoires délaissés, économie criminelle prospère. Quand la loi ne structure plus la vie réelle, quand la sécurité varie selon le code postal, quand l’effort collectif retombe toujours sur les mêmes, la démocratie perd sa crédibilité avant même de perdre ses institutions. Ce n’est pas une question de morale. C’est une question de souveraineté vécue.
Oui, la démocratie doit se transformer pour survivre dans un monde redevenu impérial. Mais pas en singeant l’empire. Elle doit redevenir capable de puissance — militaire, industrielle, technologique — sans mise en scène martiale. Réinvestir le régalien sans gesticulation. Recréer de la cohésion. Dire clairement que la liberté a un coût. Et surtout, ne pas mentir sur ce coût.
Le danger n’est pas la transformation. C’est la transformation sans cap, dictée par la peur ou l’imitation.
La vraie question n’est donc pas de savoir si la démocratie est moralement supérieure. Elle l’est, sans doute. Mais l’histoire ne se règle pas à la morale. La question est plus rude : sommes-nous prêts à payer le prix matériel, social et politique de notre autonomie sans renoncer à ce qui fait la démocratie ? Pas de réponse confortable. Juste une certitude : une démocratie immobile disparaît. Une démocratie qui se transforme sans vigilance se renie. Entre les deux, il n’y a pas d’autoroute. Juste un passage étroit.